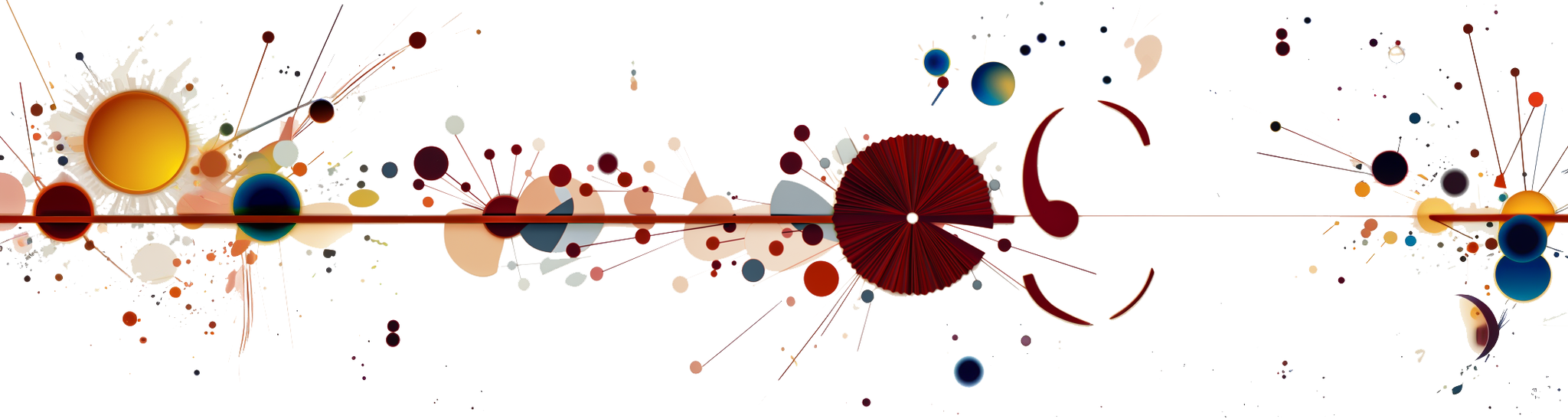Un trait remarquable de l’activité scientifique est sa capacité à formuler des propositions et à les évaluer par un examen empirique minutieux. Ce processus d’évaluation qu’est la méthode expérimentale, peut permettre d’enrichir les théories, de les comparer et de mettre en évidence leurs limites. Cette méthode a notamment permis à la physique de connaître un développement accéléré depuis sa généralisation, tirant profit de la précision des hypothèses formulées par l’usage des mathématiques et de la possibilité de mettre en place des expériences contrôlées.
Cet aspect n’est cependant pas aussi structurant dans tous les domaines de l’activité scientifique. Il est en effet bien plus aisé de formuler des propositions précises, lorsqu’on dispose d’un cadre mathématique et de leur offrir des situations empiriques pour les mettre à l’épreuve dès lors qu’on peut isoler le système que l’on étudie. Cela permet de limiter l’incursion d’éléments extérieurs, indirects ou indésirables : d’externalités. Cette “mise sous cloche” permet de faire correspondre l’objet abstrait de la théorie avec l’objet réel, de produire et d’observer les phénomènes recherchés. Autrement dit, la possibilité de contrôler la nature joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la méthode expérimentale en physique.
Sans cela, il reste toutefois possible de recourir à des expériences “naturelles”, en recherchant des configurations passées ou présentes satisfaisant à la situation théorique recherchés. On recourt fréquemment à ce type d’expériences dans les disciplines historiques comme la linguistique, la biologie évolutive, la cliodynamique ou encore l’astrophysique. Ce type d’expérience est notamment populaire dans les sciences humaines et sociales pour soutenir les études comparatives.
Les expériences naturelles ne se substituent cependant que difficilement aux expériences contrôlées. L’incursion nécessaire d’éléments extérieurs dans les situations advenues naturellement, tend à brouiller le phénomène étudié en produisant des corrélations fallacieuses ou des nouveautés inattendues au regard de la théorie.
On peut alors se demander si les disciplines recourant à des expériences naturelles sont amenées à développer leur propre expériences contrôlées ? Et ainsi converger vers l’idéal que constitue la physique, pour les tenants d’une vision positiviste. Ou alors, si plusieurs pratiques des sciences sont amenées à coexister en raison même de la nature de leur objet d’étude – quitte à ce que les théories qu’elles proposent ne puissent pas faire l’objet d’une comparaison empirique. La première hypothèse semble naïve en raison des difficultés méthodologiques effectives qui peuvent surgir lors de l’étude des systèmes sociaux et biologiques. Tandis que la seconde pose également problème, dans la mesure ou la possibilité de comparer et sélectionner différentes explications est au cœur de la démarche scientifique.
Il semble toutefois possible de proposer au moins une troisième voie en s’extrayant de la dualité entre les systèmes de la physique tenus pour objectifs, et ceux des sciences sociales généralement considérés comme subjectifs et dépendant de constructions sociales. Cette voie peut consister à supposer une continuité entre ces domaines et ainsi adopter une approche naturaliste en considérant que tout ce qui existe peut-être expliqué par des principes naturels. A condition toutefois de prendre garde à ne pas tomber dans un réductionnisme naïf ou un positivisme qui tenterait d’importer les méthodes des premières aux secondes.
Cette approche, qui se veut à la fois naturaliste et anti-réductionniste, est défendue par la philosophie pragmatiste. Au sein de cette philosophie, on peut trouver une théorie sur la formation des valeurs tenant pour centrale la notion d’expérience et se proposant de rendre compte de la manière dont se forment et se transforment les catégories que nous utilisons pour nous représenter et interagir avec le monde.
Croyances et formation des valeurs
Succinctement, le pragmatisme consiste en un anti-dogmatisme radical visant à proposer des outils permettant de penser le monde comme des relations changeantes entre des choses changeantes. Cette mutabilité fondamentale du monde a pour conséquence de cantonner l’idée traditionnelle de vérité à celle de croyance qu’il faut sans cesse réexaminer.
Contrairement à la croyance mythologique, la croyance pragmatiste repose sur la stabilisation de schémas de pensées et de théories, au travers d’habitudes pratiques et de relations expérimentées entre des « choses ». En particulier, les croyances constituent l’idée que certaines causes ont certains effets. Cependant, rien n’étant parfaitement stable et isolé, les mêmes causes conduisent parfois à des effets distincts ou ambigus. Les habitudes sont alors souvent mises à mal par l’apparition de nouveautés, des découvertes conduisant à une période d’enquête. Au cours de celle-ci, de nouvelles croyances et in extenso de nouvelles habitudes sont produites et stabilisées à partir des anciennes en s’accommodant des faits nouveaux (ce qui n’est pas sans faire écho au travaux de Thomas Kuhn sur les révolutions scientifiques).
Les croyances, au sens pragmatiste, consistent donc en un ensemble de propositions sur la relation entre certaines causes et certaines conséquences. Notre appréciation de ces dernières est cependant partielles, dans le sens où nous choisissons de porter notre intérêt sur certaines conséquences plutôt que d’autres. Ce choix peut se justifier par le fait que nous ayons des attentes, qu’elles soient explicites car prescritent par une théorie (on recherche à mesurer la variation d’une observable spécifique). Ou implicite car nous avons pris l’habitude d’examiner le monde à la lumière de certaines catégories, souvent induites par nos sens et notre culture (les distances, le temps, les couleurs, les formes, le prix etc…).
Porter notre intérêt sur la relation entre certaines conséquences et certaines causes, nous conduit à envisager le réel au travers de catégories dans lesquelles nous considérons certaines choses comme équivalentes car contribuant identiquement à cette relation. Cela permet également de comprendre les premières comme des fins visées et les secondes comme des moyens hypothétiques pour les atteindre. Si je souhaite uniquement me rendre à un endroit, je considérerais identiquement deux voitures peu importe leur couleur.
Ainsi, pour le dire autrement, les croyances consistent à proposer qu’une cause, prise comme moyen, permet de couvrir une partie de la distance entre une situation initiale et une situation finale recherchée. Cette proposition permet de formuler un jugement sur l’adéquation effective entre moyens et fins – la distance effective parcourue – entre ces deux situations. Soit évaluer dans quelle mesure une cause induit effectivement les conséquences attendues.
Avoir en vue une situation finale et disposer d’une métrique pour évaluer la distance qui nous en sépare sont donc liées. Ainsi, si je souhaite me rendre à Paris, je suis amené à considérer la distance comme métrique permettant d’évaluer la distance (géographique dans ce cas), entre ma situation actuelle et la situation recherchée, et donc à porter mon intérêt sur des choses comme moyens pour couvrir cette distance. De cette manière, je mets dans une catégorie commune un ensemble de choses (de causes) par le fait qu’elles constituent des moyens (voiture, vélo, train…). A priori équivalent, il est possible de préciser ses fins pour hiérarchiser les moyens. S’intéresser aux temps de parcours ou au CO2 émis par exemple permet de préférer un moyen à un autre. Cette hiérarchisation peut alors prendre une forme qualitative (bien, mal, etc.), ou quantitative (mètre par seconde par kg de CO2…
Bien qu’en pratique, il soit rare d’expliciter et de préciser nos fins, nous employons tout de même des valeurs. Cette autonomie apparente du système de valeurs (objets d’intérêt et hiérarchie) peut se comprendre par le développement d’une habitude détachée de ses circonstances ; le fantôme de fins passés. Comme nos activités nous amènent des régularités au sein de nos expériences, cette autonomie apparente apparaît comme économe. Elle nous expose cependant au risque d’une inadéquation entre l’horizon des moyens envisagés et l’existence de nouvelles fins.
Ainsi notre aptitude protensive (à nous projeter dans le futur), nous amène à formuler des fins explicitement ou implicitement. Ces fins, une fois atteintes ou en voie d’accomplissement sont amenées à être révisées par les nouveaux éléments apparus lors de sa réalisation. Que ces éléments aient été produites directement par notre quête ou non. Cela conduit les pragmatistes à faire une différence entre la situation finale telle qu’imaginée « fin-en-vue » (end-in-view), et la situation finale effective « fin-en-effet » (end-in-effect). Les conséquences concrètes résultent de l’expérience de la situation finale. Cela permet ainsi de juger l’adéquation entre les moyens mis en œuvre, les fins recherchées et les fins effectives, de produire une évaluation.
Rechercher des fins distinctes ou avoir une expérience passée différente nous amène à porter notre intérêt sur des choses distinctes et évaluer différemment les nouvelles expériences. Le fait qu’il n’y ait pas de fins nécessairement communes nous amène à produire alors des catégories différentes, des systèmes de valeurs incommensurables. C’est d’ailleurs précisément parce qu’il n’y a pas de fin en soi qu’il est important de s’intéresser à la formation des valeurs*.
* Comme le soulignent Alexandra Bidet, Louis Quéré et Gérôme Truc dans la traduction du livre de John Dewey, “ La formation des valeurs.
On peut toutefois remarquer que nous avons tendance à projeter des fins similaires et donc à former des systèmes de valeurs communs. Cela peut s’expliquer par le fait que nous partageons une histoire, un environnement et des dispositions sensorielles similaires. En bref, nous partageons des expériences communes qui nous amènent à porter notre intérêt sur des choses similaires, à adopter une manière semblable de comprendre le monde. Le fait de partager des fins est très utile car cela nous permet de pouvoir comparer nos croyances et les moyens qu’elles supposent. Ainsi que d’avoir des unités de mesures communes de la distance que ces moyens permettent de parcourir pour arriver à ces fins. Nous partageons alors des catégories et sommes en capacité de confronter nos manières de hiérarchiser les choses ; nos visions du monde deviennent comparables.
Réviser l’activité scientifique
Cette conception, en proposant une explication générale de la manière dont nous avons tendance à nous représenter le monde, permet d’établir une continuité entre notre activité organique et politique et l’activité scientifique.
La formulation de propositions précises et de situations expérimentales qui sont communément tenues pour des standards scientifiques, ne tient qu’au fait que nous partagions des fins spécifiques. C’est-à-dire que nous acceptions de porter notre attention sur un aspect particulier du monde et de le mesurer dans des unités similaires. Comme démontré précédemment, bien que nous ne soyons pas tenus d’accepter cela, s’accorder sur des fins précises permet de s’accorder sur des propositions falsifiables.
Si l’approche pragmatiste est subversive pour une conception traditionnelle de “la Science”, c’est parce qu’elle oblige à préciser les fins recherchées de sorte qu’elles puissent être elles aussi soumises au débat. Pour reprendre le terme développé par Thomas Kuhn dans son livre La structure des révolutions scientifiques, il s’agit de préciser dans quel paradigme nous formulons nos propositions, de préciser les observables et l’ensemble des situations spécifiques qui justifient leur définition et permettent leur observation. En physique, cela pourrait s’illustrer par la définition de l’énergie et des dispositions matérielles particulières mises en œuvre afin qu’elle soit conservée. Cela implique dès lors d’expliciter le fait que sa conservation n’est pas une loi universelle mais une propriété dans un dispositif expérimental spécifique consistant à réduire les frottements et isoler le système étudié de son environnement (au regard de cet observable**). Etienne Klein résume bien cela :
“L’expérience est une opération active visant à formater le registre et la forme des données que la nature nous livre de sorte que celles-ci s’adaptent à notre grille de lecture. Elle est alors un dispositif coercitif qui oblige la nature à exhiber des nombres, produire des phrases, selon un vocabulaire et une grammaire qui ne sont pas les siens.” Etienne Klein dans Sciences & Société
** La relation entre les contraintes induites et la définition d’une observable est un vaste sujet qui dépasse l’horizon de cet article, il a cependant été partiellement abordé dans le cadre de la biologie.
Ceci étant dit, les théories et modèles scientifiques sont utiles dans la mesure où ils nous permettent de dire des choses du monde en portant notre attention sur certains phénomènes et en définissant certains objets ; ils nous offrent une partition du monde des catégories et des instruments pour le rendre intelligible. Définir des catégories et donc porter notre intérêt sur des observables particulières nous permet de dire des choses effectivement utiles et pertinentes, mais seulement au regard de situations (de fins) spécifiques.
Cette conception relationnelle nous garde alors de tenir pour absolue, de « réifier » certaines observables. Pour le dire de façon provocante, Dieu n’a pas créé l’univers avec l’énergie, les atomes, les gènes ou les éléments chimiques, pas plus qu’il ne l’a créé avec les monades, l’impetus ou le phlogistique (qui sont des observables ayant été utilisé dans l’histoire des sciences). Toutes ces conceptions existent dans un paradigme donné et dans l’adéquation avec des outils de mesures et des situations expérimentales propres. Chercher l’origine de ces observations ailleurs que dans notre propre activité revient peut ou proue à tourner en rond, comme Arthur Eddington le souligne élégamment.
« Nous avons trouvé une étrange empreinte sur les rivages de l’inconnu. L’une après l’autre, nous avons élaboré de profondes théories, pour rendre compte de son origine. Finalement, nous avons réussi à reconstituer la créature qui a déposé cette empreinte. Et voilà ! C’était la nôtre » citation d’Arthur Eddington (chap 9, p 200, space time and the gravitation : an outline of the general relativity theory).
Réviser ainsi l’activité scientifique peut être éclairant dans le cadre de l’étude des systèmes sociaux. La pluralité des observables, des catégories pour les décrire peuvent alors être comprises comme autant de “fins-en-vue”, d’objectifs d’études distincts. On peut expliquer cette diversité de plusieurs manières. D’une part, en raison du fait que contrairement aux sciences expérimentales, il est difficile d’isoler l’objet d’étude ou d’homogénéiser et donc d’éviter l’apparition pathologique d’éléments nouveaux venant déstabiliser les catégories établies. D’autre part, on peut expliquer cela par l’intrication entre les sciences sociales et notre activité politique, qui nous amène à nourrir des intérêts distincts.
Un exemple éclairant du danger de la réification d’une partition singulière du monde peut être vue avec le PIB, qui porte notre attention sur la quantité et la valeur totale des biens produits par une économie. C’est un indicateur utile si l’on souhaite maximiser la production, mais il peut se révéler dangereux si on le tient pour mesure objective, exhaustive et unique de l’économie dans son ensemble. Elle détourne par exemple notre attention du coût écologique et humain, ce qui semble pourtant avoir des conséquences indirectes mais effectives sur la production, et surtout les autres objectifs implicites (qui ne font pas l’objet d’un indicateur) comme la survie de notre espèce. Ainsi, en réifiant un indicateur, on le détache de ses intentions et de son contexte. On rend alors autonome un système de valeur qui devient semblable à un Frankenstein, détaché du contrôle de son créateur ***. Et cela à des conséquences très concrètes dans le cas du PIB : soustraire les fins au débat amène à sa dépolitisation.
*** Pour reprendre la métaphore de Philippe Lorino dans son livre “Pragmatism & Organization studies”, Chap 8.
A l’inverse, on peut considérer le choix d’observables et d’indicateurs comme une forme de cécité choisie et nécessaire. Cela en raison du fait qu’on ne peut simultanément porter notre attention partout au risque de perdre en intelligibilité et donc en capacité d’action. Il devient alors possible de réviser notre vision du monde, et de changer de focale pour s’ajuster à la découverte de conséquences nouvelles. L’exemple des “externalités” écologiques en économie est encore une fois très éclairant sur le sujet !
Conclusion
En résumé, les habitudes et les croyances que nous développons constituent le prisme rendant notre expérience du monde intelligible. Elle nous offre une partition du monde, des catégories que l’on partage sous forme de symboles et qui permettent de produire du sens lors de leur usage dans des situations spécifiques, à l’image de la relation entre une carte et un territoire. Cependant, l’habitude, le consensus et la régularité de nos expériences peut créer la tentation de tenir pour absolue (de réifier), une partition particulière du monde, de confondre le mot et la chose (ou la carte et le territoire. On soustrait alors les fins vers lesquelles elle est dirigée au débat et oublions qu’elle ne tient qu’à leur égard. Dans le cas du PIB cela conduit à dépolitiser le débat.
On peut comprendre la méthode expérimentale comme la mesure effective de l’adéquation entre certaines causes et certaines conséquences et son efficacité, par la possibilité de limiter l’interférence d’autres éléments dans la situation étudiée. Réciproquement, sans la possibilité de réguler ces interférences, il devient difficile de choisir sur quelles causes et quelles conséquences porter notre intérêt.
Ainsi, la variabilité des expériences que nous faisons du social et l’impossibilité d’homogénéiser ces expériences par le contrôle, conduit à des difficultés pour stabiliser les fins dans lesquelles nous l’étudions. C’est-à-dire, les causes et les conséquences sur lesquelles porter notre attention. On peut voir là une distinction entre les sciences sociales et les sciences expérimentales comme la physique.Toutefois, nous pouvons occasionnellement nous accorder sur des fins communes, par exemple lorsque nous faisons de la politique. Cet accord nous permet ensuite de définir des indicateurs permettant l’évaluation des moyens mis en œuvre pour poursuivre ces fins.

Sans cet accord sur les fins, pas de systèmes de valeurs, de catégories ou d’observables communes. Les moyens apparaissent alors comme incommensurables et il devient impossible de confronter les différentes croyances. L’illusion du canard-lapin forme un bon exemple de cela. L’animal qui nous apparaît est celui que l’on s’attend à voir, sans attentes communes, rien ne garantit que nous verrons la même chose. De même que nous ne pouvons nous accorder sur la carte pertinente à utiliser si nous nous rendons dans des endroits différents.
Si les fins ne sont pas partagées, l’évaluation des moyens ne peut l’être non plus. Les tenants de croyances distinctes (d’une adéquation entre certains moyens et certaines fins) apparaissent alors comme des locuteurs de langues différentes.
On pourrait d’ailleurs poursuivre la métaphore linguistique abordée dans un article précédent sur le social comme langage, et voir les catégories comme des mots et les systèmes de valeurs comme des langues répondant à des environnements et des enjeux spécifiques. Ainsi, les inuits ont près de 50 mots pour décrire la neige alors que nous n’en avons en français que quelques-uns. Cela ne signifie nullement qu’il existe un conflit entre 50 nuances ontologiques de neiges et quelques autres, mais seulement que différents rapports au monde (différentes cartes) coexistent.
Nicolas Salerno, 2024
Remerciement à Hélène, Avel, Frederic, Raphael et Emilie pour la relecture
Référence et Bibliographie :
- La formation des valeurs, John Dewey, traduit par Alexandra Bidet, Louis Quéré et Gérôme Truc
- Pragmatisme & étude des organisations, Philippe Lorino
- Les échelles de l’esprit, Bunpei Yorifuji
- La carte et le territoire, Alfred Korzybski
- La structure des révolutions scientifiques, Thomas Kuhn
- Sciences & Société, les normes en question, p27-44, Etienne Klein